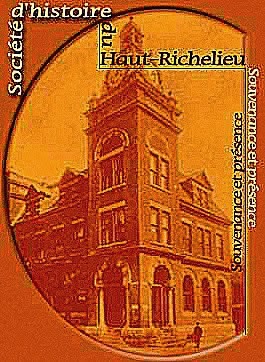L’hiver 1608-1609 a été particulièrement dur et long aux
alentours de la petite bourgade de Québec.
Le froid a été vif et la neige rare, ce qui a rendu à peu
près improductive la chasse au gros gibier.
La disette a sévi chez les Montagnais installés dans le
voisinage et a tué ou invalidé la presque totalité du petit groupe de Français
qui avait choisi d’hiverner dans le fort construit l’été dernier en face de
l’étranglement du grand fleuve.
Le commandant Samuel de Champlain a, pour sa part, conservé
tous ses moyens, car, quel que fût le temps, il s’était forcé à sortir à
l’extérieur tous les jours.
Mâchouillant un morceau d’écorce ici, avalant un bout de
branchette là, il avait réussi à se prémunir contre le scorbut qui avait décimé
son groupe.
Durant ces excursions, et durant ses moments de loisirs, il
avait eu tout le temps de songer à l’avenir qu’il souhaitait pour la colonie de
peuplement qu’on l’avait chargé d’implanter.
Il avait une vision très claire de tout cela, basée
totalement sur la nécessaire amitié à entretenir avec les peuplades autochtones
sur place.
Cela avait bien réussi, jusque là, avec les peuples nomades
parlant des langues dérivées de l’algonquin, mais cela s’était heurté au refus
net et violent des tribus iroquoises.
Celles-ci étaient universellement honnies par les
Algonquiens et même par les Hurons en raison des attaques constantes et
cruelles qu’elles infligeaient à tous.
Champlain avait néanmoins à de nombreuses reprises tenté
des approches diplomatiques, libéré des prisonniers en les chargeant de
messages d’amitié et essayé de nouer des relations commerciales.
Tout avait échoué.
Alors Champlain s’est résolu à suivre une autre voie.
Il se rendrait à la demande instante de ses alliés montagnais
et participerait à une expédition militaire contre les Iroquois.
Non pour les punir.
Non pour les exterminer. Non pour
leur infliger des dommages irréparables, mais simplement pour leur montrer que
dorénavant, les attaques contre les Français et leurs alliés deviendraient
beaucoup plus coûteuses.
Au début du mois de juillet 1609, il s’engage donc avec sa
troupe dans la Rivière des Yroquois
(notre Richelieu), premiers Européens à remonter ce magnifique cours d’eau.
Déjà, des centaines de guerriers autochtones ont déserté
et, arrivés aux chutes en amont du bassin de Chambly, ce sont des Européens qui
sont renvoyés à Québec.
Ils ne sont plus que 3 Français et une soixantaine
d’Amérindiens, mais Champlain montre une telle détermination qu’ils poursuivent
leur chemin.
Le 14 juillet, ils arrivent au grand lac et Champlain,
mettant en pratique une coutume immémoriale, lui donne son nom.
Tout l’éblouit dans ce paysage : la vaste étendue du
lac lui-même, la multitude d’îles boisées piquant sa surface, l’abondance du
gibier, la splendeur des Montagnes Vertes et des Adirondacks qu’il aperçoit au
loin.
Il note aussi que la région est inhabitée en raison des
guerres incessantes qui s’y déroulent.
Ils sont bien en territoire ennemi.
L’affrontement aura lieu le 30 juillet. 200 guerriers iroquois sont retranchés dans
un fort (près de Ticonderoga, dans le New York).
Champlain a réussi à se cacher jusqu’au dernier moment
tandis que ses 60 alliés amérindiens se lancent à l’attaque.
Soudain, il se montre, met en joue des chefs indiens et en
abat deux d’un seul coup qui achèvera aussi une 3e victime.
3 guerriers en une seule fois. Voilà un coup de feu qui va changer
durablement toute l’histoire de l’Amérique du Nord[1].